Enseignement & recherche
23 décembre 2024
Blog
#Prix thèse
#Concours
#Résultats
Le Prix de Thèse Sphinx récompense les travaux des jeunes docteurs, en Sciences de Gestion, en Sciences de l’Information et de la Communication et en Sciences de l’Education, dont les travaux sont d’une grande qualité notamment sur le plan méthodologique. La procédure de sélection est présidée par M. Younès BOUGHZALA (Ph.D en sciences de gestion) et Pr. Jean MOSCAROLA, professeur émérite à l’Université de Grenoble.
Procédure de sélection
La procédure de sélection s’est déroulée en 3 étapes :
- l’appel à candidature,
- une phase de pré-sélection,
- et une deuxième phase de désignation des lauréats.
Au total, 15 candidatures de différentes disciplines ont été reçues : 2 en Marketing, 2 en GRH, 1 en SI, 1 en Gestion de projet, 5 en Finance, 3 en Management et 1 en Sciences de l’éducation.
Le jury de pré-sélection qui s’est tenu le 18 novembre 2024 a retenu 5 finalistes. Après examen des différentes évaluations envoyées par les membres de jury, les présidents de jury ont décerné le 18 décembre 2024 le premier prix de Thèse Sphinx de 1500 euros à Madiha BENDJABALLAH pour sa thèse intitulée : « La rencontre de service triadique client/instrument technologique/vendeur : Le rôle et l’effet de l’instrument technologique comme moyen d’action et médiateur des interactions sociales vendeur/client » », préparée à l’Université de Lorraine sous la direction du professeur Christian DIANOUX et Mme Sandrine HEITZ-SPAHN.
Le premier prix
Cette recherche intéresse tant les praticiens que les recherches en marketing. En effet, dans le cadre des interactions au sein des points de vente de plus en plus marquées par la tendance croissante des vendeurs et des clients à utiliser leurs instruments technologiques propres, Mme Bendjaballah étudie au-delà du paradigme « low tech, hightech », la place que joue l’instrument technologique dans la rencontre de service client/vendeur. L’objectif étant d’examiner la façon dont la rencontre de service triadique se déroule pour comprendre les rôles de chacun des acteurs et la façon dont l’instrument technologique peut venir les modifier.
Sur le plan théorique, cette recherche comble le gap théorique quant à la littérature ancrée dans le paradigme « low tech/ high touch ». La revue de la littérature est particulièrement intéressante car elle permet, grâce à un codage textuel, de présenter les concepts de rencontre de service dyadique vendeur/client et la rencontre du service triadique vendeur/instrument technologique/client et met en évidence les rôles de chaque acteur dans la rencontre de service. Cette recherche s’inscrit dans la lignée des travaux sur la perception sociale qui considère deux dimensions dans la perception sociale ou interpersonnelle de l’individu : celle liée à la chaleur humaine de l’individu (ou encore la sociabilité) et celle liée à la compétence de l’individu.
L’approche méthodologique
Pour répondre à ses quatre objectifs de recherche, Mme Bendjaballah a opté pour une méthodologie mixte. La phase qualitative exploratoire, conjuguant une observation et entretiens semi-directifs menés auprès de 17 clients, de 21 vendeurs et de 5 experts managers et consultants, a permis à la fois d’identifier la façon dont la rencontre de service triadique se déroule et également de comprendre les rôles de chacun (client, vendeur et instrument technologique) et les tensions qui en découlent. Un modèle conceptuel avec 17 hypothèses a été proposé et trois études expérimentales quantitatives, auprès de 699 répondants, reposant sur la méthode des scénarios sont ainsi menées pour comprendre la façon dont les clients perçoivent le vendeur assisté du MSA durant trois moments de la vente : la prise de contact, l’argumentaire de vente et la conclusion de la vente.
Plusieurs analyses ont été conduites pour mener à bien ces études : le codage textuel pour catégoriser les données, test des hypothèses de la recherche ainsi que le test des effets de médiation et de modération, des ACP, T test, le test de sphéricité de Bartlett, Tests de médiation simple, Tests des médiateurs en parallèle, test de significativité du modèle global avec les 17 hypothèses de recherche … Pour ce faire, plusieurs logiciels ont été utilisés : Nvivo, SPSS et d’autres logiciels tels que le logiciel Pivot Animator pour créer des vidéos animés, le logiciel Veyon pour l’état d’avancement lors du pré-test des scénarios des études expérimentales, le logiciel Power G pour déterminer le nombre de répondants par cellule expérimentale ou encore le logiciel Qualtrics pour l’administration du questionnaire.
Les résultats
Plusieurs résultats émanent de ce travail de recherche. Les résultats de l’approche qualitative montrent que la rencontre de service vendeur/client est davantage marquée par l’utilisation de l’instrument technologique du vendeur que l’instrument technologique du client, que les moments d’interaction avec l’instrument technologique et la façon de l’utiliser apparaissent comme des éléments d’appréciation de la rencontre de service et enfin que l’utilisation de la technologie MSA (Assistant de vente mobile) est perçue différemment par les clients et soulèvent un certain nombre d’interrogations quant à la perception du vendeur, particulièrement en termes de chaleur et de compétence. L’approche quantitative quant à elle montre que lors des phases de prise de contact et d’argumentaire de vente, lorsque le vendeur utilise le MSA, il est perçu moins chaleureux et moins compétent par le client alors que dans la phase de conclusion de la vente la compétence perçue du vendeur ne semble pas jouer un rôle déterminant et qu’il est également perçu moins chaleureux par le client quand il utilise le MSA. Cela dit, le MSA apparaît ainsi comme une barrière à l’interaction avec le client et ce quel que soit la phase de la vente. Ce constat confirme d’autres travaux théoriques qui montrent qu’un certain nombre de vendeurs craignent que l’utilisation de l’instrument technologique vienne diminuer leur rôle d’expert auprès des clients. Il est alors important réfléchir à la meilleure façon de l’utiliser en considérant tant l’intérêt du vendeur que du client.
Mme Bendjaballah propose que Le MSA ne doit pas se substituer au vendeur, à qui appartient l’expertise dans cette relation, mais l’accompagner dans sa mission et que clients et vendeurs pourraient discuter plus aisément autour d’un contenu partagé. Mme Bendjaballah montre enfin que Le MSA peut être privilégié pour offrir de la réactivité et de la fluidité dans le parcours du client et peut être utilisé avec davantage de parcimonie pour les tâches décisionnelles, que l’on peut caractériser comme la phase de présentation et d’argumentation technique du produit.
Le second prix
Le second prix de Thèse Sphinx, de 1000 euros a été décerné à Nada Kanita pour sa thèse intitulée « La gestion de la dette technique dans le cadre des pratiques Agile et DevOps », réalisée à Nantes Université sous la direction du professeur Frantz Rowe.
La thèse de Mme Kanita traite d’un sujet d’actualité pour la plupart des entreprises, notamment du numérique. En effet, l’accélération des initiatives de transformation technologique, pour répondre aux évolutions du marché du numérique, a généré une quantité importante de dette technique. Dans ce cadre, cette recherche a pour objectifs la compréhension du phénomène de la dette technique (formes et sources de la dette contractée) dans les contextes Agile et DevOps, l’analyse de l’implication de la dette technique dans la suppression ou la création d’options numériques, l’étude de l’impact des décisions relatives à la dette technique sur la rigidité inhérente de l’organisation et enfin l’analyse des approches de remboursement qui ont été appliquées à chaque forme de dette produite dans ces contextes de développement. L’originalité de cette recherche réside dans les six travaux qui la constituent et qui sont le résultat d’un processus évolutif d’affinement et d’analyse.
Concernant l’état de l’art, Mme Kanita explique le concept de la dette technique, inspiré du contexte financier de la dette et appliqué au développement de logiciels. Elle met ensuite la lumière sur deux approches de gestion de la dette technique, à savoir l’approche Agile et DevOps. Mme Kanita explique, à travers le prisme des options numériques, que la dette technique peut être contractée intentionnellement ou non et peut aussi être stratégique pour permettre d’exploiter/créer de nouvelles opportunités numériques et bénéficier d’avantages compétitifs sur le marché numérique. Ces mêmes options numériques sont aussi source de nouvelle dette technique. Mme Kanita s’intéresse au concept de l’inertie organisationnelle, tels que l’inertie psychologique, l’inertie cognitive, l’inertie sociotechnique, l’inertie politique et l’inertie économique qui entrave la bonne gestion de la dette technique. En effet, la routinisation des pratiques organisationnelles garantit l’efficience du système mais crée un blocage à toute tentative de changement. Enfin, Mme Kanita rappelle les facteurs organisationnels qui contribuent à la dette technique, notamment la pression liée aux délais, l’incapacité à maintenir un niveau de qualité élevé et le manque de budget alloué à la mise en œuvre des exigences de qualité, et montre qu’ils sont insuffisants à la compréhension de la relation entre la rigidité de base d’une organisation et les décisions liées à la dette technique.
L’approche méthodologique
D’un point de vue méthodologique, Mme Kania a mobilisé la méthode BIBGT pour l’explication du concept de la dette technique. Cette méthode propose de combiner la bibliométrie et la Grounded Theory pour mener une revue de littérature (Walsh & Rowe, 2023). Par ailleurs, cette recherche adopte une approche mixte qualitative et quantitative selon une approche exploratoire et séquentielle. Dans un objectif d’exploration du phénomène de la dette technique, quatre études de cas multiples longitudinales avec une stratégie comparative entre cas ont été menées. Les indicateurs du niveau de la dette technique ont été mesurés statistiquement. Des entretiens semi-directifs et des observations sont venus compléter chaque phase de collecte de données statistiques et ont permis d’identifier les facteurs d’inertie qui impactent la gestion de la dette technique et de tirer des conclusions par rapport à l’évolution de la dette technique dans le contexte DevOps. Enfin, dans le cadre de la partie qualitative de cette recherche, 51 entretiens semi-directifs avec différents acteurs impliqués dans le processus de gestion de la dette technique ainsi que des observations participantes auprès des équipes des DSI étudiées ont été conduits.
Par ailleurs, plusieurs données secondaires (rapports d’activité, documentation technique, courriels, etc.) ont été analysées. Plusieurs outils logiciels ont été utilisés tout au long de cette recherche. Tout d’abord le logiciel ARTIREV pour l’analyse bibliométrique des données sur la base de 161 publications, la méthode SQALE pour mesurer la dette technique, le logiciel Open Source SonarQube pour la collecte des données quantitatives afin de mesurer la dette et le logiciel R pour analyser les données quantitatives. Plusieurs analyses ont été conduites. Pour la partie qualitative de cette recherche et dans un objectif d’identification et de hiérarchisation des articles ayant un impact dans la littérature, deux principales analyses ont été utilisées : l’analyse de co-citation de références (RCCA) et l’analyse du couplage bibliographique de documents (DBCA). Dans le cadre de l’approche quantitative, plusieurs analyses ont été réalisées : T test, analyse de variance, tests de corrélation…
Les résultats
Les résultats de cette thèse sont nombreux. Mme Kanita a tout d’abord montré que la dette technique est multiforme et multifactorielle contribuant ainsi à la littérature sur l’identification des formes et des facteurs favorisant la production de la dette technique dans les deux contextes étudiés. Elle a ainsi identifié trois formes de la dette technique, produites dans les contextes Agile et DevOps : la dette architecturale, technologique et fonctionnelle et a montré que le remboursement de la dette s’opère selon trois types distincts : un traitement systémique, partiel ou différé. Concernant la question de l’inertie organisationnelles, elle a montré à travers sa deuxième étude que l’inertie et en particulier ses dimensions sociotechniques, économiques et politiques permettent de théoriser la production de la dette technique. Cela confirme empiriquement que le phénomène d’inertie favorise non seulement la production de la dette technique mais entrave aussi sa bonne gestion. Par ailleurs, cette recherche contribue à une meilleure compréhension de l’implication du phénomène de la dette technique dans l’évolution des trajectoires de transformation numérique des organisations.
En effet, Mme Kanita montre que les entreprises peuvent exploiter la dette stratégique pour saisir les opportunités qui se sont présentées au sein de leur écosystème et qu’il existe une interaction dynamique entre la production de dette technique et le degré de rigidité des routines organisationnelles. Cette recherche apporte aussi une réponse au poids de de la dette technique produit dans les deux contextes et montre que celui généré dans le contexte DevOps est supérieur à celui produit en Agile et que cela s’explique par les problèmes de compatibilité après la mise en place de DevOps et la forte exigence attendue de l’équipe DevOps en termes de calendriers des livraisons. Enfin, à travers la dernière étude, qui mesure la dette technique à l’issue de migration du contexte Agile au contexte DevOps, les résultats montrent que, quel que soit l’approche de développement adoptée, le rythme de livraison rapide peut compromettre la qualité du logiciel et favoriser ainsi la production de la dette.
Toute l’équipe Sphinx félicite les deux lauréates pour la qualité de leurs travaux.
Cette édition a été coordonnée par Inès BOUZID, Enseignant-chercheur/Responsable du Prix de thèse Sphinx.
À lire aussi

Enseignement & Recherche : Optimisez vos missions pédagogiques
Avec Le Sphinx, garantissez des réponses scientifiques à vos projets avec la fiabilité et la polyvalence des solutions d’enquêtes Sphinx.
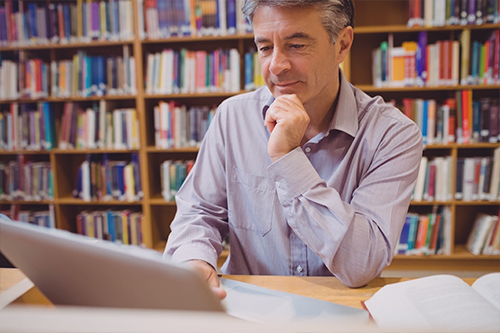
Solution de collecte de données pour les chercheurs
Vous menez des travaux de recherche ? Vous réalisez régulièrement des études quantitatives et qualitatives ou souhaitez les confier ? Découvrez la solution Sphinx.

Offre enseignement
Sphinx, la solution d’enquêtes et d’analyses de données dédiée aux enseignants, aux chercheurs et aux étudiants.
